Situés en Inde du Sud, The Thinnai et The Grand Anicut partagent un fil conducteur de voyages dans le temps et d’histoires entremêlées : The Tribune India
https://www.tribuneindia.com/news/reviews/story/set-in-south-india-the-thinnai-and-the-grand-anicut-share-a-common-thread-of-time-travel-and-intertwining-histories-325636
[ad_1]
Bindu Menon
THINNAI, qui signifie en tamoul une véranda ombragée, est le décor organique du roman éponyme d’Ari Gautier. C’est depuis cette mince maison d’une banlieue ouvrière de Pondichéry qu’un vieux clochard, Gilbert Thaata, raconte l’histoire captivante de la fortune de sa famille, s’étalant sur des siècles. « Le Grand Anicut » de Veena Muthuraman, quant à lui, suit les aventures de Marcellus, un prince marchand de Rome, qui vient commercer au Tamilakam, alors florissant sous la domination Chola. Les deux romans, mis à part le décor de l’Inde du Sud, peuvent sembler avoir peu de points communs. Pourtant, il y a un fil conducteur pas si ténu : voyage dans le temps, voyages fantaisistes, entrelacement d’histoires et de personnages divers.
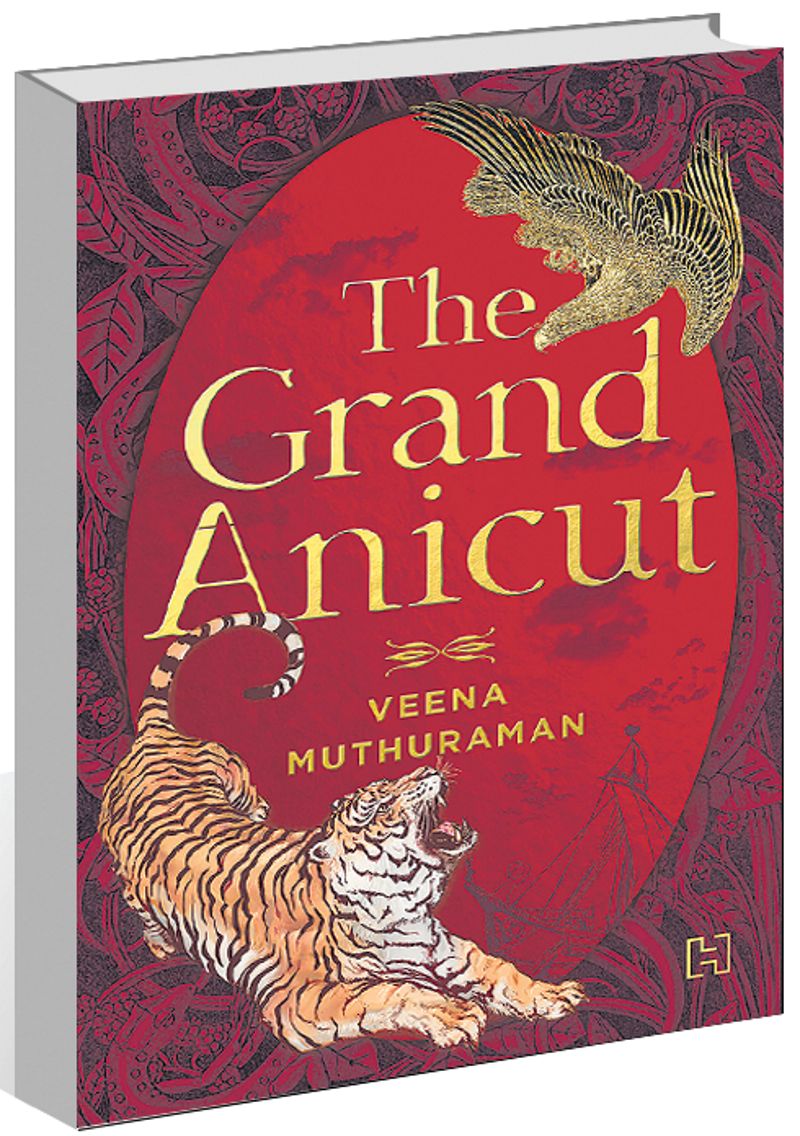
Le roman français de Gautier, magistralement recréé en anglais par Blake Smith, offre une vue chromatique de Pondichéry. Alors que Gautier guide le lecteur dans les rues de la ville, capturant les nombreuses complexités des communautés tamoule, française et créole et cartographiant ses nombreuses histoires, coloniales et post-coloniales, il déballe un Pondichéry assez éloigné de celui qui fait les gros titres des touristes. Même un tout petit détail sur Kurusukuppam, où l’on voit une multitude de personnages s’envoler, est riche en contours culturels.
L’histoire commence avec le retour du narrateur dans sa maison et constate de nombreux changements visibles dans le quartier. Depuis le thinnai, un référentiel de souvenirs, il se souvient de son enfance et fait défiler une foule de personnages – Three-Balls Six-Faces, Emile Kozhukkattai-Head, Pascal Pig-Tail et bien d’autres avec des histoires pleines d’esprit sur la façon dont ils ont obtenu les surnoms.
A travers Lourdes, la servante créole, Gautier plonge dans la culture et la cuisine créolisées méconnues, les chants et la danse. Nous apprenons, par exemple, qu’il existe deux types de créoles. Les descendants des colons français, qui parlaient français pur, étaient les Hauts Créoles, qui « méprisaient les Bas pour leur ascendance portugaise, anglaise, danoise, écossaise ou hollandaise ». Ainsi, alors que les hauts créoles vivaient dans de pittoresques maisons coloniales dans la ville blanche, les bas créoles étaient repoussés vers des villages de pêcheurs comme Kurusukuppam, « ignoré par les Indiens et méprisé par les hauts créoles ». De telles pépites mettent en lumière les politiques compliquées et les crises d’identité, ainsi que la coexistence d’héritages coloniaux et de sous-cultures locales dans un Pondichéry post-colonial.
Le roman fait des allers-retours, faisant allusion aux soldats français qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, les célébrations du 14 juillet, la sécession de 1962, l’essaimage des ashramites, la culture hippie, la drogue, etc. jusqu’à ce qu’il s’arrête à nouveau au Thinnai. , où le Français ratatiné Gilbert Thaata commence à raconter son histoire. C’est une saga familiale tragique, liée à un mystérieux diamant volé, la Pierre de Sita. Les histoires de voyageurs au bord du chemin, se reposant au Thinnai après un voyage las, sont-elles réelles ou le fruit de leur imagination fébrile ? Il n’y a pas de réponses ici.
Muthuraman tente une refonte similaire de l’histoire, à une échelle assez ambitieuse, dans son roman « Le Grand Anicut ». La période est d’abord CE, un âge d’or au Tamilakam, sous le souverain Chola Karikalan. Karikalan a tenu à distance les Pandyas, les Cheras et les Satkarnis du nord, et consacre son énergie à des projets d’infrastructure, notamment un barrage le long du Cauvery, ou le grand anicut.
C’est à cette époque qu’un navire romain transportant le marchand Marcellus et son équipage arrive à Puhar, la capitale Chola. Marcellus est ostensiblement venu faire le commerce d’épices, de pierres précieuses et d’animaux de cirque, mais en réalité porte une missive de son père pour une personne mystérieuse. C’est une mission pleine de dangers et qui le mènera à travers le Tamilakam, à la rencontre de puissants marchands et prêtres, colporteurs et aubergistes, espions et bandits. Alors que le voyage ardu à l’intérieur des terres le mène jusqu’au projet favori du roi, le grand anicut, Marcellus se retrouve entraîné dans la politique complexe et les intrigues de palais du pays. Comme s’il était en boucle, il continue d’être enlevé, emprisonné et libéré. Et au cours de ces mésaventures, il rencontre de nombreux personnages, trompeurs, intrigants et intéressants, comme lui.
Il y a Zhang, le moine bouddhiste évangélisateur et partenaire de confiance ; Vallavan, ami et ennemi à intervalles intermittents ; Angavai, reine des bandits et héroïne d’une histoire d’amour improbable et peu développée ; et plus important encore, Kuzhali, la sœur aînée de Vallavan et la fille veuve d’un marchand de Puhar. Fait intéressant, le lecteur fait également la connaissance de la sœur cadette de Kuzhali, Kannaki, qui est fiancée à Kovalan. Mais l’histoire de Kannaki est destinée à un autre jour, et à une autre épopée où elle sera canonisée comme une héroïne tragique.
Les influences littéraires de Muthuraman sont assez évidentes. Le voyage de Marcellus est antérieur à celui d’un autre héros d’une autre épopée, Vandiyathevan du roman toujours populaire de Kalki, « Ponniyin Selvan », et le sujet d’un prochain multi-vedette. Muthuraman a reconnu que ce classique culte tamoul était une inspiration évidente pour son livre. Mais elle admet qu’elle était moins intéressée par les rois et les guerres et plus investie dans les gens et les cultures avec lesquels ils interagissaient.
En ce sens, Muthuraman et Gautier méritent des applaudissements pour avoir fait revivre des passés peu connus et les destins interconnectés des peuples et des nations. Les deux livres semblent dissiper toute compréhension unitaire et hégémonique de l’histoire de l’Inde.
[ad_2]
Source link




